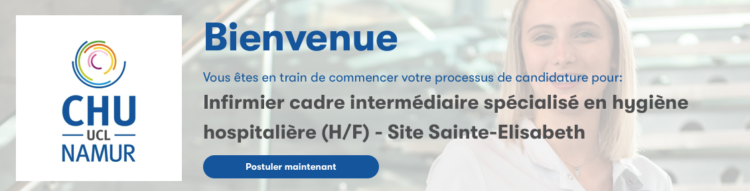La prévention et le contrôle des infections (PCI) dans les hôpitaux de soins aigus de Flandre : pratiques actuelles de surveillance et de retour d’information par les équipes en charge de la PCI
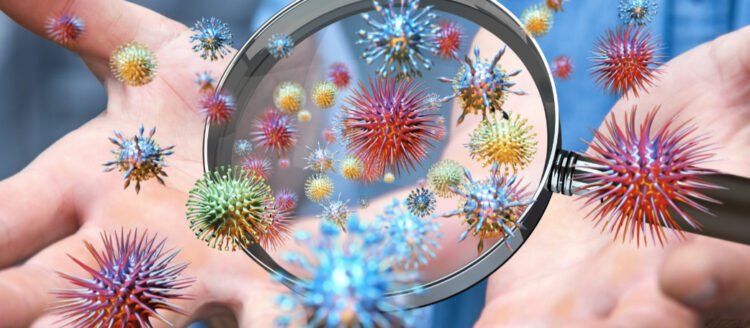
Historique :
La surveillance et le retour d’information constituent des éléments essentiels de la prévention et du contrôle des infections (PCI) (1). En Belgique, les hôpitaux sont tenus d’évaluer leurs programmes de prévention et de contrôle des infections au moyen d’indicateurs de qualité fixés au niveau fédéral (2). Toutefois, ces indicateurs visent principalement à déterminer si un suivi est effectué et ne fournissent que peu ou pas d’informations sur les méthodes utilisées, la manière dont les retours d’information sont communiqués ou la manière dont les résultats contribuent à l’amélioration de la qualité.
Objectif
L’objectif est d’obtenir un aperçu détaillé des méthodes de suivi et de retour d’information utilisées couramment dans les hôpitaux aigus de Flandre. En parallèle, les principaux facilitateurs et obstacles au sein de ce processus sont également identifiés. L’accent est mis sur les pratiques de PCI suivantes dans les soins de santé : hygiène des mains, nettoyage et désinfection de l’environnement immédiat du patient, politique d’isolemenassociated urinary tract infectiont et prévention des quatre principales infections associées aux soins (CAUTI = catheter associated urinary tract infection, CLABSI : central line associated bloodstreaminfection, POWI = postoperatieve wondinfection et VAP/HAP = ventilator associated pneumonia. Pour cartographier le processus de surveillance et de retour d’information, l’accent a été mis sur le respect des indicateurs structurels et procéduraux.
Méthodologie
Cette étude a utilisé à une stratégie d’échantillonnage ciblée afin d’inclure un groupe diversifié d’hôpitaux de soins aigus flamands. Le choix a été effectué en tenant compte de la répartition géographique, du type et de la taille de l’hôpital, ainsi que de son statut d’accréditation. Des entretiens semi-structurés ont été réalisés jusqu’à atteindre la saturation des données, laquelle a été observée avec un échantillon final composé de quinze hôpitaux. Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse thématique, conduite selon une approche à la fois déductive et itérative.
Résultats
1.1 Objets de surveillance et retour d’information
Tous les hôpitaux étudiés procèdent à une surveillance et à un retour d’information, en mettant l’accent sur l’hygiène des mains, la politique d’isolement et la prévention des infections liées aux soins. L’hygiène des mains est le domaine le plus fréquemment observé, même si les observations demandent beaucoup de travail et que l’effet Hawthorne influence la fiabilité. L’approche en matière de nettoyage de l’environnement varie considérablement et s’inscrit généralement dans le cadre d’un projet ou d’une analyse des risques.
La gestion de l’isolement est abordée de manière systématique à l’aide d’échantillons aléatoires et de listes de tâches dans le DPI, en s’appuyant également sur des observations sur le lieu de travail et la collaboration avec le service de transport des patients. La fréquence varie, de ponctuelle à hebdomadaire. La surveillance dans le cadre de la prévention des infections liées aux soins se concentre principalement sur les ICC et les UAC ; les PAVM et les ISO font l’objet d’un suivi moins approfondi.
La sélection des points à surveiller repose sur les plans stratégiques, les analyses de risques et les obligations légales. Dans les hôpitaux universitaires, elle est également influencée par les exigences de programmes d’accréditation tels que JACIE ou Magnet.
1.2 Méthodes de collecte et d’analyse de données
La collecte des données dans les hôpitaux se fait principalement de manière manuscrite, sur papier, notamment lors des observations et des audits. Elle peut également être numérique, par exemple via le dossier médical électronique. L’analyse des données est le plus souvent réalisée manuellement dans Excel, à l’aide de tableaux et de graphiques. Malgré un intérêt croissant pour l’automatisation, le processus demeure laborieux et fortement dépendant de l’intervention humaine. Certains établissements développent des tableaux de bord internes, mais un besoin important en outils standardisés et en soutien technique persiste.
« Si on pouvait améliorer la collecte des données, l’analyse devrait automatiquement s’en trouver facilitée. Le fait que notre collecte de données soit encore largement manuelle rend également l’analyse plus difficile » (hôpital M, communication personnelle, 4 avril 2024).
1.3 Méthodes de retour d’information
Le retour d’information s’effectue à plusieurs niveaux. Le feedback direct et individuel reste rare, se limitant principalement à l’observation de l’hygiène des mains. Le retour d’information à l’échelle de l’équipe passe généralement par des tableaux de bord ou des indicateurs de qualité. Il est plus fréquemment adressé au personnel soignant qu’au personnel médical.
À l’échelle de l’hôpital, le retour d’information se fait surtout par le biais de rapports transmis aux chefs de service ou lors d’échanges en face à face. Pour les collaborateurs, il prend souvent une forme passive, via l’intranet, des bulletins d’information ou des tableaux de bord.
Le comité d’hygiène hospitalière constitue le principal lieu de concertation pour faire remonter les informations aux dirigeants et aux autres parties prenantes. Par ailleurs, les équipes de prévention et de contrôle des infections (PCI) participent régulièrement à des réunions de chefs de service ou d’équipes. La majorité des hôpitaux bénéficient de la reconnaissance et de la confiance de leur direction, même si certains soulignent que le retour d’information demeure parfois unidirectionnel.
« Les services facilitaires ont souvent moins accès à ces outils en ligne et sont moins familiarisés avec ceux-ci. Il est donc d’autant plus important de passer par les chefs de service » (hôpital I, communication personnelle, 14 mars 2024).
1.4 Méthodes d’intégration dans les stratégies d’amélioration
Bien que les résultats du suivi soient utilisés pour mettre en place des plans d’action, le cycle PDCA de Deming n’est que rarement mis en œuvre jusqu’au bout. Le manque de temps et de personnel entrave le suivi des points d’action, empêchant parfois les améliorations. Il est nécessaire de mettre en place une approche plus systématique et un planning réaliste en matière de retour d’information et de suivi.
« Pour certaines données, nous préférerions aller plus loin, car actuellement, cela reste parfois trop limité. Le cycle n’est pas toujours bouclé. Nous collectons, nous interprétons, nous relayons, nous déterminons des points d’action pour certains services, mais nous n’avons pas le temps d’assurer le suivi de ces points d’action » (hôpital B, communication personnelle, 18 avril 2024).
1.5 Facilitateurs et obstacles
Une bonne dynamique d’équipe, une collaboration interdisciplinaire efficace et le soutien de la direction contribuent à un suivi de qualité. Les équipes de prévention et de contrôle des infections se sentent reconnues et bénéficient d’une certaine autonomie.
Cependant, plusieurs obstacles persistent : une charge de travail élevée, des ressources limitées, une automatisation encore insuffisante des processus et un manque de capacités de gestion des données. En l’absence de soutien informatique adapté, le traitement des données demeure particulièrement chronophage.
La disparition de l’accréditation externe (ISQua, remplacée par FlaQuM) a entraîné la perte d’incitatifs externes pour certains établissements. Enfin, bien que de nombreux hôpitaux expriment leur volonté d’investir dans des améliorations, leurs contraintes financières en freinent souvent la mise en œuvre.
1.6 Recommandations
Il est recommandé de privilégier une communication ouverte, de favoriser la collaboration multidisciplinaire, d’intégrer les données de PCI dans les systèmes existants et de limiter le suivi aux priorités réalisables. Dans le même temps, de nombreuses équipes de prévention et de contrôle des infections soulignent qu’il est difficile de formuler des recommandations à d’autres équipes en raison d’une visibilité limitée sur leurs approches respectives.
Les recommandations adressées à BAPCOC appellent à des réformes structurelles, notamment une révision du cadre juridique afin de garantir des effectifs adéquats, incluant un soutien administratif suffisant et un nombre approprié d’équivalents temps plein par hôpital. Il est également essentiel d’assurer la transparence, une représentation active des travailleurs dans l’élaboration des politiques, ainsi qu’une stratégie claire et cohérente à long terme, en particulier dans le cadre des réseaux hospitaliers tels que HOST.
Sur le plan technologique, il est recommandé de développer des outils nationaux uniformisés pour le suivi, le retour d’information et la visualisation des données, de mettre en place des systèmes numériques en temps réel, ainsi que de prévoir l’accompagnement par des experts en gestion des données.
Par ailleurs, les recommandations insistent sur la nécessité d’améliorer la communication interne et externe, de renforcer la formation continue des professionnels en PCI, de rédiger des lignes directrices concrètes et standardisées et de réaliser des audits externes. Enfin, une attention particulière est portée à la promotion d’une culture organisationnelle positive, dans laquelle le travail des équipes PCI est pleinement reconnu et valorisé.
Conclusion
Si une surveillance est généralement bien mise en œuvre, une approche systématique et normalisée fait souvent défaut. Le suivi est davantage curatif que préventif et s’inscrit rarement dans un cycle PDCA complet assorti de stratégies d’amélioration. Les hôpitaux et les décideurs politiques doivent accorder la priorité à l’élaboration de plans de surveillance structurés, appuyés par une infrastructure informatique renforcée et des stratégies claires en matière de retour d’information, de suivi et d’assurance qualité. Ces éléments sont essentiels pour améliorer l’efficacité des actions de prévention et de contrôle des infections.
Références
1. Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national and acute health care facility level. Genève : Organisation mondiale de la santé (2016) : Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
2. Sciensano. Indicateurs de qualité pour la prévention et le contrôle des infections dans les hôpitaux aigus, Bruxelles 2011, Disponible sur : https://www.sciensano.be/fr/projets/indicateurs-de-qualite- pour-la-prevention-et-le-controle-des-infections-dans-les-hopitaux-aigus
Nouveautés
Agenda scientifique
- janvier 2026
-
27/01
Symposium georganiseerd door de BICS, ABIHH en WIN Opleiding van zorgprofessionals in infectie-preventie en controle (IPC)
- mars 2026
-
5/03
Kennis delen samen sterker – intercollegiale uitwisseling infectiepreventie (CONTRAIN)
-
21/03
Symposium Séminaire de diagnostic des maladies infectieuses.(SSID)
-
26/03
WZC symposium – zorginfecties en antimicrobiële resistentie (SCIENSANO)
- juin 2026
-
du 3/06 au 5/06 || à Lille
36ème Congrès de la Société Française en Hygiène Hospitalière (SF2H)